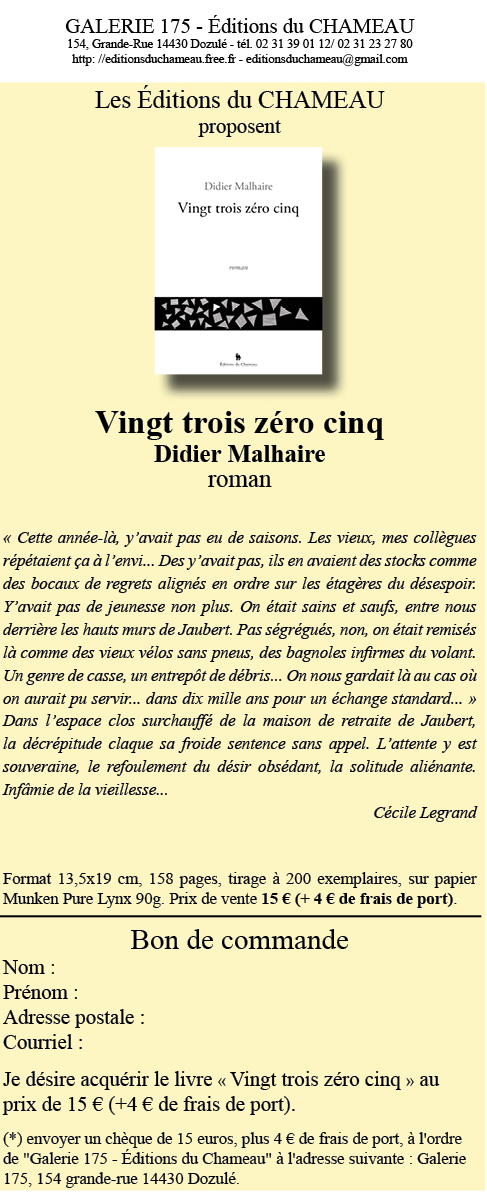"Vingt trois zéro cinq", 2016
Didier Malhaire
roman
roman
Deuxième roman très attendu de Didier Malhaire...
Prix du Roman gay 2017

« Cette année-là, y’avait pas eu de saisons. Les vieux, mes
collègues répétaient ça à l’envi... Des y’avait pas, ils en avaient des
stocks comme des bocaux de regrets alignés en ordre sur les étagères du
désespoir. Y’avait pas de jeunesse non plus. On était sains et saufs,
entre nous derrière les hauts murs de Jaubert. Pas ségrégués, non, on
était remisés là comme des vieux vélos sans pneus, des bagnoles
infirmes du volant. Un genre de casse, un entrepôt de débris... On nous
gardait là au cas où on aurait pu servir... dans dix mille ans pour un
échange standard... » Dans l’espace clos surchauffé de la maison
de retraite de Jaubert, la décrépitude claque sa froide sentence sans
appel. L’attente y est souveraine, le refoulement du désir obsédant, la
solitude aliénante. Infâmie de la vieillesse.
Pour tromper l’oubli et combattre la menace du silence, le narrateur se fait l’écho d’une voix empreinte de soif et de résignation, qui le tance sévèrement ou avec indulgence, légitimant espoir et désarroi. « Mes mots, ils battent comme des bêtes contre l’enclos mort de mes oreilles et ils remontent jusqu’à mon front. Il s’y entassent. Ils tapent. Ils gigotent. Ils s’amassent les uns par-dessus les autres. Un jour, je me dis que mon front, il va se lézarder sous la poussée de tous ces mots. J’aurai une corne, là, entre les yeux. Dis, Docteur Rock Marlon ? Est-ce que ça pleure, les licornes ? » Dans cette atmosphère aussi désarmante et désopilante qu’un remake de En attendant Godot, là où Beckett tarit ses personnages de mots, Didier Malhaire opte pour leur abondance, comme pour conjurer l’absence et la déréliction, et sa poésie n’en est que plus virulente et émouvante. Comme si la raréfication des plaisirs avait fini par déculper tous les sens. à exciter les oreilles, à faire tressaillir les paupières, à défoncer le palais. Les mots se bousculent et si le vieux semble parfois se mélanger les pinceaux, ce n’est que pour redonner des couleurs au présent, à l’ineffable, à l’éternel...
Pour tromper l’oubli et combattre la menace du silence, le narrateur se fait l’écho d’une voix empreinte de soif et de résignation, qui le tance sévèrement ou avec indulgence, légitimant espoir et désarroi. « Mes mots, ils battent comme des bêtes contre l’enclos mort de mes oreilles et ils remontent jusqu’à mon front. Il s’y entassent. Ils tapent. Ils gigotent. Ils s’amassent les uns par-dessus les autres. Un jour, je me dis que mon front, il va se lézarder sous la poussée de tous ces mots. J’aurai une corne, là, entre les yeux. Dis, Docteur Rock Marlon ? Est-ce que ça pleure, les licornes ? » Dans cette atmosphère aussi désarmante et désopilante qu’un remake de En attendant Godot, là où Beckett tarit ses personnages de mots, Didier Malhaire opte pour leur abondance, comme pour conjurer l’absence et la déréliction, et sa poésie n’en est que plus virulente et émouvante. Comme si la raréfication des plaisirs avait fini par déculper tous les sens. à exciter les oreilles, à faire tressaillir les paupières, à défoncer le palais. Les mots se bousculent et si le vieux semble parfois se mélanger les pinceaux, ce n’est que pour redonner des couleurs au présent, à l’ineffable, à l’éternel...
Cécile Legrand

Introduction
Dans Le Roi du Lard (Roman, Prix des lycéens de Caen en 2014), Didier
Malhaire évoquait avec une très grande sensibilité les souvenirs de
deux enfants dont l’amitié évoluait petit à petit en une relation
amoureuse très pure, avant que leur innocence ne soit violée par un
pathétique personnage homophobe, grossier et totalement abject. La vie
ayant avancé, ils renouaient leurs liens et se redécouvraient à
l’occasion d’un enterrement, dans l’authenticité de leurs sentiments.
C’est un monde diamétralement opposé que l’auteur explore avec ce deuxième roman, intitulé Vingt trois zéro cinq. Nous sommes immergés, cette fois, au plus creux d’une maison de retraite ou vivent (survivent ?) des hommes dont la fin de parcours ne les empêche pas d’être mus par une énergie farouche pour exprimer leur différence, refuser la soumission, s’échapper à eux-mêmes et se raccrocher à leurs désirs, à leurs fantasmes.
Vingt trois zéro cinq est la tragédie d’une fin de quelque chose qui touche à la sexualité, et à l’amour devenu impossible ou socialement indécent. La virtuosité du style de Didier Malhaire, maîtrisé jusqu’à la cruauté verbale, frappé d’un humour sauvage, fait que cette « politesse du désespoir », devient une poésie accomplie, une façon de nommer les choses jusqu’à la muflerie ravageuse et tonique de certains passages.
Vingt trois zéro cinq est un texte pas facile, et passionnant. Qui se partage entre un monologue intérieur quasi polyphonique et des dialogues imbriqués de fragments de mémoire, des descriptions lyriques et des formes brutales de réalisme. Les personnages sont fous d’une vie qui s’achève et s’est perdue, fous de souvenirs disloqués et prégnants comme autant de blessures et de joies disparues mais présentes en hallucination.
Proche, dans un premier temps, des techniques du nouveau roman à la Nathalie Sarraute, sans y être pourtant inféodée, la technique narrative de Didier Malhaire fait que souvent les personnages, le narrateur et l’écrivain, se confondent sans véritablement se constituer. L’intrigue est une suite de lambeaux qui ne cessent de s’épuiser dans une tentative d’autonomie et de cohérence qui les dépasse dans le tourbillon des souvenirs. Le temps retrouvé est chaotique, tellement présent qu’il en est déchirant, violent, insupportable en raison de la frustration liée à la disparition de l’autre qu’on a aimé. Comme dans le cheminement de Dante, on procède de cercle en cercle, mais on ne rejoint qu’une absence de Paradis ou un enfer de désirs qui se ne se résignent pas à l’atténuation. Avec, en récurrence, ce chiffre énigmatique : 2305.
Un chiffre énigmatique dont on découvre le sens dans les pages de la fin et qui éclaire le drame de ce délire apparent né d’un traumatisme dont nous pénétrons les arcanes grâce à quelques « gnossiennes ». Gnossiennes ? Le mot, inventé par éric Satie, évoque le labyrinthe où l’on risque de se perdre s’il n’y avait ce fil d’Ariane dans l’après coup, au moment où le narrateur-auteur-personnage nous permet, in fine, de reconstruire le puzzle.
C’est un monde diamétralement opposé que l’auteur explore avec ce deuxième roman, intitulé Vingt trois zéro cinq. Nous sommes immergés, cette fois, au plus creux d’une maison de retraite ou vivent (survivent ?) des hommes dont la fin de parcours ne les empêche pas d’être mus par une énergie farouche pour exprimer leur différence, refuser la soumission, s’échapper à eux-mêmes et se raccrocher à leurs désirs, à leurs fantasmes.
Vingt trois zéro cinq est la tragédie d’une fin de quelque chose qui touche à la sexualité, et à l’amour devenu impossible ou socialement indécent. La virtuosité du style de Didier Malhaire, maîtrisé jusqu’à la cruauté verbale, frappé d’un humour sauvage, fait que cette « politesse du désespoir », devient une poésie accomplie, une façon de nommer les choses jusqu’à la muflerie ravageuse et tonique de certains passages.
Vingt trois zéro cinq est un texte pas facile, et passionnant. Qui se partage entre un monologue intérieur quasi polyphonique et des dialogues imbriqués de fragments de mémoire, des descriptions lyriques et des formes brutales de réalisme. Les personnages sont fous d’une vie qui s’achève et s’est perdue, fous de souvenirs disloqués et prégnants comme autant de blessures et de joies disparues mais présentes en hallucination.
Proche, dans un premier temps, des techniques du nouveau roman à la Nathalie Sarraute, sans y être pourtant inféodée, la technique narrative de Didier Malhaire fait que souvent les personnages, le narrateur et l’écrivain, se confondent sans véritablement se constituer. L’intrigue est une suite de lambeaux qui ne cessent de s’épuiser dans une tentative d’autonomie et de cohérence qui les dépasse dans le tourbillon des souvenirs. Le temps retrouvé est chaotique, tellement présent qu’il en est déchirant, violent, insupportable en raison de la frustration liée à la disparition de l’autre qu’on a aimé. Comme dans le cheminement de Dante, on procède de cercle en cercle, mais on ne rejoint qu’une absence de Paradis ou un enfer de désirs qui se ne se résignent pas à l’atténuation. Avec, en récurrence, ce chiffre énigmatique : 2305.
Un chiffre énigmatique dont on découvre le sens dans les pages de la fin et qui éclaire le drame de ce délire apparent né d’un traumatisme dont nous pénétrons les arcanes grâce à quelques « gnossiennes ». Gnossiennes ? Le mot, inventé par éric Satie, évoque le labyrinthe où l’on risque de se perdre s’il n’y avait ce fil d’Ariane dans l’après coup, au moment où le narrateur-auteur-personnage nous permet, in fine, de reconstruire le puzzle.
Serge Mauger
Format 13,5x19cm, 158 pages, tirage numérique en 200
exemplaires, sur papier Munken Lynx 90g. ISBN : 978-2-917437-78-0. Prix de vente 15 € (+ 4 € pour frais de port). Si vous souhaitez acquérir
un exemplaire, vous pouvez télécharger un BON de COMMANDE (au format pdf) et envoyer un chèque
de 15 € plus 4 € de frais de port,
à l'ordre de "Galerie 175 - Éditions du Chameau", au 154 grande-rue
14430 Dozulé.
Papiers découpés sur la couverture, Christine Duflo (christineduflo.e-monsite.com).
Pour une commande entre 2 et 4 livres les frais de port s'élèvent à 7 €.
Au-delà, nous contacter.
Papiers découpés sur la couverture, Christine Duflo (christineduflo.e-monsite.com).
Pour une commande entre 2 et 4 livres les frais de port s'élèvent à 7 €.
Au-delà, nous contacter.
Extraits du livre :
... J’ai secoué mes 70 kilos d’arthrose, de rhumatisme, asthme,
incontinence et autres joyeusetés et j’ai planté là Loulou. En partant,
mon oreille gauche n’a rien enregistré. Côté discrétion, je peux
compter sur elle. Et puis, elle ne mérite pas de médaille, Loulou
n’était pas dans son champ d’activité, alors elle avait tout à la
fermer. J’ai glissé sur mes chaussons jusqu’à la salle de resto. C’est
la cantine des vieux. Elle murmurait déjà de la présence de mes
congénères. C’est dingue, les vieux, y’a pas plus discrets, ils ferment
les portes au ralenti, ils n’ouvrent jamais leur fenêtre de peur de
s’envoler, ils glissent plus qu’ils ne marchent, et quand ils roulent
sur leur fauteuil, on croirait qu’ils sont montés sur coussins d’air.
Mais pour la bouffe, ça mandibule, ça caquette, ça s’affûte le dentier,
ça s’aiguise les doigts, ça lisse sa serviette, ça se cale sur sa
chaise comme dans un starting-block. Et puis le silence… Et soudain,
c’est comme un bourdonnement. D’abord indistinct, et d’un coup, ils
vrombissent tel un essaim d’abeilles autour d’un pot de miel. Ils
mastiquent dans un bruit d’usine. Un bruit monotone qui s’écrase sur
les vitres sales du réfectoire.
Yvette dodeline de la tête. Elle fixe le fond transparent de son assiette comme une suicidaire la profondeur d’un puits. Yvette déjeune seule à sa table. Yvette goûte seule à sa table. Yvette dîne seule à sa table. Yvette crèvera seule sous la table. Yvette c’est une vieille pute. C’est un pléonasme, les putes c’est toujours des vieilles putes. Surtout pour les plus vieilles qu’elles, pour les plus moches, les plus coincées des ovaires qu’elles ! Les Yvette, ça n’a rien à faire ici, rien parmi les honnêtes gens surtout avec sa perruque de travers. En vrais cheveux, des cheveux de blondes, on en crève. On viendrait à en réclamer notre dose de chimio pour abandonner nos bouclettes violettes ramassées en tas sur le ratatiné de nos têtes. Les bonshommes, ils salivent encore devant cette salope, comme si avec leur prostate défaillante, leurs couilles qui leur pendent aux genoux, ils pouvaient encore prétendre à quelque chose ! Ils bavent à sa vue comme des escargots. Les hommes c’est d’une autre espèce que nous, convenez-en, ce sont des gastéropodes, ils marchent avec leur queue gluante, et la seule trace qu’ils laissent, qu’ils nous laissent ce sont leurs moutards qui nous ont abandonnés là, dans ce pourrissoir même pas classe, alors qu’eux, nos vieux, ça fait un sacré bout de temps que les vers leur ont bouffé les génitoires !...
... Yvette-Rita bleue. Bleue sous le dôme bleu de l’escalier.
Vous avez eu peur ?
Yvette dans la verdeur de la maison. Elle glisse, fumée d’encens sur le salpêtre qui ronge les murs. Yvette-Rita ses ongles teints de violet sur le sang séché de ma bouche. Yvette-Rita comme un lierre autour de mes poignets qui les tord jusqu’à me faire gueuler. Yvette-Rita. Elle défonce à coups de pied les valises que la mer a rapportées. Yvette-Rita que je tente de repousser. Yvette Sangsue. Sa bouche sanguine collée au battement de la veine sous la peau de mon cou. Yvette-Rita sifflante et rapide, serpent sinueux sur la géométrie du dallage.
Vous avez peur ! Flash sur le vestibule assombri. Flash sur les rideaux qui respirent pendus aux fenêtres de la nuit. Flash sur le bleu d’église du parachute de verre de l’escalier. Flash sur le salon peuplé des fantômes des fauteuils, des canapés. Flash sur la fraîcheur des bouteilles vides de la cuisine. Flash sur le silence avide des tapis. Flash sur ma main tremblante dans le noir. Flash sur les valises oubliées. Flash sur le sillon de sable collé à la blessure de ma bouche. Flash. Flash. Flash. Flash. Flash.
Yvette-Rita recroquevillée sur le tabouret du piano. Ses mains blanches dorment dans un accord désarticulé.
- Yvette… Rita… C’est moi… Vieni… Rita… répondez.
Soupir des fenêtres.
- Yvette… Déconnez pas… Je suis revenu… Me laissez pas…
Odeur de suie de la cheminée éteinte.
- Rita, demain, on fera ce que vous voudrez… Les valises…Rita…
Le crissement des souris sous les planchers.
- Rita-Yvette… Vous allez prendre froid…
Mon reflet dans le brouillard du miroir.
- Bordel, Yvette, j’en ai marre de votre cinéma.
Le souffle de Rita sur la poussière du piano.
- Qu’est-ce que vous voulez ? Un verre d’eau ?
Les yeux de Rita plus sombres que la noirceur de la nuit.
- Vous m’en voulez ? Pourquoi ?
Le doigt fin de Rita sur l’ébène du piano.
- 2305 ?
L’ongle de l’annulaire de Rita sur le 2305 de ma peau.
- J’ai oublié…
La paume froide de Rita sur la boursouflure des numéros effacés.
- Je n’ai pas pu… tout enlever…
Le rouge à lèvres violet de Rita sur le noir des chiffres tatoués.
- 2305…
La chance gravée sur la peau ridée de mon avant-bras…
- Oubliez la peur ?...
... Tu restes muet gamin. Tu dois avoir la langue collée au palais. Je le sens. Je le sais. Machinalement, tu passes ta langue sur tes dents. Tu aimes ça. La sensation de ta langue sur tes dents. Ça te rassure. Tu te sens vivant. Ta langue sur l’émail, la douceur, la dureté de tes dents. Ta salive irrigue la digue de tes dents. Et pourtant, ton dos me dénonce la sécheresse de ta bouche. Ben oui, dénonce. Faudrait que tu apprennes gamin à ne faire confiance en rien, en personne, même ton dos te dénonce. Tu restes muet et pourtant, même ton dos te dénonce. Tu as la bouche à marée basse. Et c’est ton dos qui est passé aux aveux. J’ai connu ça. Il y a si longtemps que ça me fait plaisir, oui plaisir de sentir ta peur. Ta peur. La peur, ça fait ressembler à un ange. Un ange, oui. Tu voudrais, j’aurais voulu devenir un ange. Un ange avec toutes ses ailes. Deux ailes, ça m’aurait suffi. Avant les coups. Avant les coups qui sont déjà là avant d’être tombés. Et l’idée des coups ça te ramène à l’idée de l’ange. Tellement la promesse des coups te fait déjà souffrir. Et tu te ratatines sur toi-même. La zébrure des poings sur ta colonne vertébrale. Tu rentres les os de ton dos vers l’intérieur de ton corps. Jusqu’à la limite de ton cœur, de tes poumons. Dans un effort, tu essaies d’incorporer tes vertèbres à tes côtes, tu aimerais faire rentrer tous tes os dans le moelleux de ton ventre. Tu crois y parvenir. Pourtant, tu sais qu’il te reste à découvert la proéminence de tes épaules, de tes omoplates. Et c’est là où l’image de l’ange s’impose à toi. Tu appréhendes déjà la douleur. Tes épaules recevront les coups les premières. Elles porteront tout le poids de la douleur. Tes bourreaux, leur taf c’est de te faire croire que ta douleur a un sens. Ce sens-là, il leur appartient. Toi, tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux plus rien comprendre. La pluie des coups sur ton dos, les gifles qui te font saliver un liquide rosâtre, tes couilles qui te remontent jusqu’au plein du ventre, toutes ces sensations aiguës comme la piqûre de fourmis rouges affolées, tout cet inconnu que tu pressentais depuis longtemps, prend soudainement un sens. Un accroc de lumière, le vol d’une poussière s’accrochent à la rétine de ton œil encore entrouvert. Tu geins. L’humidité de ta bouche coule en un filet froid le long de ton cou. Tu geins. Ta poitrine frémit sur le froid de la pièce. Tu t’endors bercé par la douleur. Ta douleur s’envole portée par les ailes de l’ange...
... Yvette-Rita postillonne dans mon dos. Elle arrose mon échine d’une salive verte et mousseuse. Des postillons atterrissent sur les marches. Des lézards bruns s’enfuient sous l’offense et se cachent dans les fissures des murs. Le gamin ne bouge pas. Le soleil réchauffe ses jambes nues. Il semble ignorer les paroles d’Yvette-Rita. Les mots d’Yvette-Rita ne lui font ni chaud ni froid dans la douceur de ce jour de mai. Je parierais que le gamin, les insultes, il les connaît toutes.
L’ombre d’Yvette. L’ombre des bras d’Yvette. Des tentacules minces s’agitent sur la pierre pourrie des marches. L’ombre de Rita. Plus pâle que l’ombre. Yvette-Rita moins vivante que son ombre. Yvette-Rita. Elle se répand sur les marches, jaunie comme une flaque d’urine.
Le gamin a sorti de sa poche une cigarette. La tête renversée, il s’offre au soleil. La fumée de sa cigarette blanchit le bleu du ciel. Le môme a tourné la tête vers Yvette.
- Madame, si vous pouviez la boucler et arrêter de bouger. J’voudrais pouvoir fumer en paix. Gardez vos insultes, elles feraient même pas peur à un chien. Il a gardé le silence un instant. Pourtant, ce qui pourrait les impressionner, les chiens, c’est votre tronche. Décidément, c’est ça : Madame Yvette vous avez une tronche à égorger les chiens… et à boire dans un verre à moutarde. Et il est parti à rire. Le rire du môme a dissous l’ombre d’Yvette. L’ombre d’Yvette-Rita réduite en poussière. L’ombre de Rita en miettes comme une biscotte happée dans un broyeur. Il flotte au-dessus de nos têtes le Madame du môme. Un Madame révérencieux comme un hoquet, un Madame à vous emporter la gueule. Un Madame de dragée au poivre. Le sucré pour le respect que l’on doit et le reste comme autant de sous-entendus que l’on ne vous pardonnera jamais. Le môme, à cet instant-là, il a déjà perdu l’impossible pardon d’Yvette-Rita.
Gnossienne n°4. La villa Carlotta à marée montante. Le flux gris des vagues. Les mouettes dansent d’une patte sur l’autre. Les mouettes s’immobilisent. Œil rond sans expression. Les mouettes unijambistes replient le souvenir de leurs pattes, partent à rire et se caltent...
Yvette dodeline de la tête. Elle fixe le fond transparent de son assiette comme une suicidaire la profondeur d’un puits. Yvette déjeune seule à sa table. Yvette goûte seule à sa table. Yvette dîne seule à sa table. Yvette crèvera seule sous la table. Yvette c’est une vieille pute. C’est un pléonasme, les putes c’est toujours des vieilles putes. Surtout pour les plus vieilles qu’elles, pour les plus moches, les plus coincées des ovaires qu’elles ! Les Yvette, ça n’a rien à faire ici, rien parmi les honnêtes gens surtout avec sa perruque de travers. En vrais cheveux, des cheveux de blondes, on en crève. On viendrait à en réclamer notre dose de chimio pour abandonner nos bouclettes violettes ramassées en tas sur le ratatiné de nos têtes. Les bonshommes, ils salivent encore devant cette salope, comme si avec leur prostate défaillante, leurs couilles qui leur pendent aux genoux, ils pouvaient encore prétendre à quelque chose ! Ils bavent à sa vue comme des escargots. Les hommes c’est d’une autre espèce que nous, convenez-en, ce sont des gastéropodes, ils marchent avec leur queue gluante, et la seule trace qu’ils laissent, qu’ils nous laissent ce sont leurs moutards qui nous ont abandonnés là, dans ce pourrissoir même pas classe, alors qu’eux, nos vieux, ça fait un sacré bout de temps que les vers leur ont bouffé les génitoires !...
... Yvette-Rita bleue. Bleue sous le dôme bleu de l’escalier.
Vous avez eu peur ?
Yvette dans la verdeur de la maison. Elle glisse, fumée d’encens sur le salpêtre qui ronge les murs. Yvette-Rita ses ongles teints de violet sur le sang séché de ma bouche. Yvette-Rita comme un lierre autour de mes poignets qui les tord jusqu’à me faire gueuler. Yvette-Rita. Elle défonce à coups de pied les valises que la mer a rapportées. Yvette-Rita que je tente de repousser. Yvette Sangsue. Sa bouche sanguine collée au battement de la veine sous la peau de mon cou. Yvette-Rita sifflante et rapide, serpent sinueux sur la géométrie du dallage.
Vous avez peur ! Flash sur le vestibule assombri. Flash sur les rideaux qui respirent pendus aux fenêtres de la nuit. Flash sur le bleu d’église du parachute de verre de l’escalier. Flash sur le salon peuplé des fantômes des fauteuils, des canapés. Flash sur la fraîcheur des bouteilles vides de la cuisine. Flash sur le silence avide des tapis. Flash sur ma main tremblante dans le noir. Flash sur les valises oubliées. Flash sur le sillon de sable collé à la blessure de ma bouche. Flash. Flash. Flash. Flash. Flash.
Yvette-Rita recroquevillée sur le tabouret du piano. Ses mains blanches dorment dans un accord désarticulé.
- Yvette… Rita… C’est moi… Vieni… Rita… répondez.
Soupir des fenêtres.
- Yvette… Déconnez pas… Je suis revenu… Me laissez pas…
Odeur de suie de la cheminée éteinte.
- Rita, demain, on fera ce que vous voudrez… Les valises…Rita…
Le crissement des souris sous les planchers.
- Rita-Yvette… Vous allez prendre froid…
Mon reflet dans le brouillard du miroir.
- Bordel, Yvette, j’en ai marre de votre cinéma.
Le souffle de Rita sur la poussière du piano.
- Qu’est-ce que vous voulez ? Un verre d’eau ?
Les yeux de Rita plus sombres que la noirceur de la nuit.
- Vous m’en voulez ? Pourquoi ?
Le doigt fin de Rita sur l’ébène du piano.
- 2305 ?
L’ongle de l’annulaire de Rita sur le 2305 de ma peau.
- J’ai oublié…
La paume froide de Rita sur la boursouflure des numéros effacés.
- Je n’ai pas pu… tout enlever…
Le rouge à lèvres violet de Rita sur le noir des chiffres tatoués.
- 2305…
La chance gravée sur la peau ridée de mon avant-bras…
- Oubliez la peur ?...
... Tu restes muet gamin. Tu dois avoir la langue collée au palais. Je le sens. Je le sais. Machinalement, tu passes ta langue sur tes dents. Tu aimes ça. La sensation de ta langue sur tes dents. Ça te rassure. Tu te sens vivant. Ta langue sur l’émail, la douceur, la dureté de tes dents. Ta salive irrigue la digue de tes dents. Et pourtant, ton dos me dénonce la sécheresse de ta bouche. Ben oui, dénonce. Faudrait que tu apprennes gamin à ne faire confiance en rien, en personne, même ton dos te dénonce. Tu restes muet et pourtant, même ton dos te dénonce. Tu as la bouche à marée basse. Et c’est ton dos qui est passé aux aveux. J’ai connu ça. Il y a si longtemps que ça me fait plaisir, oui plaisir de sentir ta peur. Ta peur. La peur, ça fait ressembler à un ange. Un ange, oui. Tu voudrais, j’aurais voulu devenir un ange. Un ange avec toutes ses ailes. Deux ailes, ça m’aurait suffi. Avant les coups. Avant les coups qui sont déjà là avant d’être tombés. Et l’idée des coups ça te ramène à l’idée de l’ange. Tellement la promesse des coups te fait déjà souffrir. Et tu te ratatines sur toi-même. La zébrure des poings sur ta colonne vertébrale. Tu rentres les os de ton dos vers l’intérieur de ton corps. Jusqu’à la limite de ton cœur, de tes poumons. Dans un effort, tu essaies d’incorporer tes vertèbres à tes côtes, tu aimerais faire rentrer tous tes os dans le moelleux de ton ventre. Tu crois y parvenir. Pourtant, tu sais qu’il te reste à découvert la proéminence de tes épaules, de tes omoplates. Et c’est là où l’image de l’ange s’impose à toi. Tu appréhendes déjà la douleur. Tes épaules recevront les coups les premières. Elles porteront tout le poids de la douleur. Tes bourreaux, leur taf c’est de te faire croire que ta douleur a un sens. Ce sens-là, il leur appartient. Toi, tu ne peux rien comprendre. Tu ne peux plus rien comprendre. La pluie des coups sur ton dos, les gifles qui te font saliver un liquide rosâtre, tes couilles qui te remontent jusqu’au plein du ventre, toutes ces sensations aiguës comme la piqûre de fourmis rouges affolées, tout cet inconnu que tu pressentais depuis longtemps, prend soudainement un sens. Un accroc de lumière, le vol d’une poussière s’accrochent à la rétine de ton œil encore entrouvert. Tu geins. L’humidité de ta bouche coule en un filet froid le long de ton cou. Tu geins. Ta poitrine frémit sur le froid de la pièce. Tu t’endors bercé par la douleur. Ta douleur s’envole portée par les ailes de l’ange...
... Yvette-Rita postillonne dans mon dos. Elle arrose mon échine d’une salive verte et mousseuse. Des postillons atterrissent sur les marches. Des lézards bruns s’enfuient sous l’offense et se cachent dans les fissures des murs. Le gamin ne bouge pas. Le soleil réchauffe ses jambes nues. Il semble ignorer les paroles d’Yvette-Rita. Les mots d’Yvette-Rita ne lui font ni chaud ni froid dans la douceur de ce jour de mai. Je parierais que le gamin, les insultes, il les connaît toutes.
L’ombre d’Yvette. L’ombre des bras d’Yvette. Des tentacules minces s’agitent sur la pierre pourrie des marches. L’ombre de Rita. Plus pâle que l’ombre. Yvette-Rita moins vivante que son ombre. Yvette-Rita. Elle se répand sur les marches, jaunie comme une flaque d’urine.
Le gamin a sorti de sa poche une cigarette. La tête renversée, il s’offre au soleil. La fumée de sa cigarette blanchit le bleu du ciel. Le môme a tourné la tête vers Yvette.
- Madame, si vous pouviez la boucler et arrêter de bouger. J’voudrais pouvoir fumer en paix. Gardez vos insultes, elles feraient même pas peur à un chien. Il a gardé le silence un instant. Pourtant, ce qui pourrait les impressionner, les chiens, c’est votre tronche. Décidément, c’est ça : Madame Yvette vous avez une tronche à égorger les chiens… et à boire dans un verre à moutarde. Et il est parti à rire. Le rire du môme a dissous l’ombre d’Yvette. L’ombre d’Yvette-Rita réduite en poussière. L’ombre de Rita en miettes comme une biscotte happée dans un broyeur. Il flotte au-dessus de nos têtes le Madame du môme. Un Madame révérencieux comme un hoquet, un Madame à vous emporter la gueule. Un Madame de dragée au poivre. Le sucré pour le respect que l’on doit et le reste comme autant de sous-entendus que l’on ne vous pardonnera jamais. Le môme, à cet instant-là, il a déjà perdu l’impossible pardon d’Yvette-Rita.
Gnossienne n°4. La villa Carlotta à marée montante. Le flux gris des vagues. Les mouettes dansent d’une patte sur l’autre. Les mouettes s’immobilisent. Œil rond sans expression. Les mouettes unijambistes replient le souvenir de leurs pattes, partent à rire et se caltent...
Le bon de souscription